" Les armoires vides " de Annie Ernaux 17/20
L'incipit et l'épilogue enclavent un traumatisant avortement pratiqué par une faiseuse d'ange, il faut dire que nous sommes à la charnière des années 50 et 60, et qu'il faudra attendre encore 14 ans avant de voir la loi Veil légaliser cette pratique.
Issue de parents tenant un modeste café-épicerie dans un quartier ouvrier d'Yvetot, Denise Lesur mène une enfance plutôt agréable et insouciante. Par contre, le jour où ses parents décident de la faire entrer dans un école privée, afin de lui permettre de suivre la meilleure éducation possible, elle prend violemment conscience de l'existence des différentes classes sociales. Vite rejetée par ses camarades pour ses humbles origines, elle décide de réagir promptement. Dés lors, gonflée d'une indéfectible volonté d'apprendre doublée de grandes facilités, elle se jette à corps perdu dans les études, veillant d'abord à obtenir la première place, puis ensuite à s'y maintenir résolument. Elle obtient ainsi la considération de tout le milieu scolaire et, en particuliers, de celles qu'elle voulait épater. Puis, prenant goût aux études, comme par un mouvement d'inertie, elle s'envolera pour toujours vers la première place du tableau d'honneur.
Insidieusement, une barrière invisible va peu à peu l'éloigner de ses parents qui ont tout fait pour lui donner des ailes. La déchirure sociale ira même, au fur et à mesure de ses études, jusqu'à lui faire éprouver une véritable honte pour ses géniteurs, puis carrément de la haine !
Les armoires vides est l'élaboration autobiographique d'une fracture sociale. Annie Ernaux dissèque, sans fioriture, sa vie de fille de commerçants, sa prise de conscience d'une autre vie possible, puis sa réussite par les études, agrémentée par la découverte d’œuvres littéraires et musicales, avec au bout l'indicible espoir de voir se dessiner une vie meilleure, aux antipodes du milieu d'où elle vient.
De prime abord, on remarque cette écriture dense, saccadée, brute et sauvage, comme jetée sur les pages blanches et jamais reprise, laissée là comme une tache indélébile de ce que fut sa vie. Cette prose accidentée est à l'image de l'état d'esprit de l'auteure, cependant, pour un lecteur lambda comme moi, on sature vite, pourtant le fond n'est pas sans intérêt, et puis naturellement, au fil des pages, on finit par s'habituer à son écriture, et avec volonté, on outrepasse l’âpreté stylistique pour enfin prendre plaisir au récit.
Derrière cette farandole ininterrompue, cette pléiade de mots, on sent une femme toujours en souffrance d'un passé pourtant lointain. Peut-être est-ce pour tenter de digérer cette ancienne douleur qu'elle la couche sur le papier, inlassablement, espérant une résilience ou une catharsis libératrice. Cela m'a inévitablement fait songer à une partie de la phrase d'Albert Londres : Porter la plume dans la plaie. Boris Cyrulnik n'est pas loin.
Néanmoins, après réflexion, n'y-a-t-il point une pointe d'exagération dans l'exaspération ? Certes, ses parents sont issus du tissu ouvrier, mais ce ne sont quand même pas des Thénardier ? Et l'enfance de Denise Lesur ne peut être assurément comparée à celle de la pauvre Cosette ?
Alors pourquoi tant de haine envers le peuple d'en bas ? Tous les prolétaires ne sont pas des miséreux. Certains, de leur condition, en tirent même une fierté, une dignité qui est tout à leur honneur. Parmi ces gens, il n'est pas si rare de trouver plus de probité et d'altruisme que derrière d'autres façades bien plus clinquantes. Alors je renouvelle ma question : Pourquoi tant de haine envers les gens de peu ? Peut-être qu'Annie Ernault, enroulée dans son rôle d'auteure, s'arroge le droit de raconter à sa manière son histoire, libre à elle d'accentuer ou d'amoindrir certains faits, de les édulcorer ou de les transcender. Après tout, à quoi bon être écrivain si ce n'est pour écrire sans liberté ?
Autant dans la description des sentiments que celle des lieux, Annie Ernaux n'édulcore rien, elle plonge franchement les mains dans le camboui, avec tout le côté péjoratif, poisseux et moisi que cela inclut. En effet, on y est de plain pied dans ce bistrot, avec les fidèles, les habitués d'un verre ou deux, les joueurs de dominos, les petits poivrots, les alcooliques notoires qu'il faut savoir mettre gentillement dehors, ceux qui paieront à la fin du mois, ceux qui vomissent parfois là où ils sont, ceux qui parlent comme ils peuvent, vertement : Verse-moi un coup de pied au cul ; sans parler des odeurs, de la crasse, de la tinette au fond de la cour avec ses exhalaisons méphitiques en cas de grosse chaleur, rien, non rien ne nous sera épargné !
De même, avec une précision froidement chirurgicale, elle remet à l'honneur des mots perdus de sa jeunesse en en truffant volontairement le texte, des mots qui fleurent bon ces années d'après guerre : Biclou, niguedouille, schnock, pistrouille, giguasse, grognasse, picrate, débagouler, carcaillot, mucre, boui-boui, gnognote, hépatoum, etc. Parfois, même internet peine à nous donner une définition digne de ce nom. Pour ceux qui ont connu cette époque, comme une madeleine proustienne, elle évoque ces magazines d'autrefois : Bonnes soirées, Confidences, Nous deux, Petit écho de la mode, La vie en fleurs, etc.
En conclusion, après un effort d'adaptation, cette lecture devient plaisante, au point même d'en redemander une fois le livre achevé, tant l’empathie se fait crescendo.
Entre honte et fierté, humiliation et épanouissement, moquerie et honneur, Annie Ernaux nous embarque, sans mélo mais avec franchise, dans ses années de jeunesse où se joue la construction d'une personnalité.

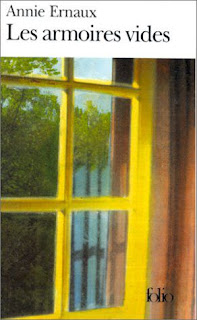
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire